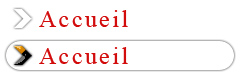Contestation ÃĐtudiante : la mÃĐprise
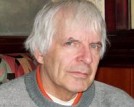 Par Michel Frankland                Â
Par Michel Frankland                Â
Le bouillonnement des ÃĐmotions nous ÃĐgare souvent sur nos vrais motifs. La dynamique des groupes lâillustre constamment. Les motifs sâentremÊlent. Un motif plus conscient, plus identifiable, sert de porte-ÃĐtendard aux autres sentiments charriÃĐs avec celui qui mÃĻne la parade. Celle du 22 avril 2012, partie du centre-ville, en constitue un exemple patent. On y constate divers niveaux de mÃĐprises.
La premiÃĻre mÃĐprise porte sur une attitude globale. Celle des aÃŪnÃĐs, baby boomers et plus ÃĒgÃĐs, se fonde sur un ordre social. Il y a une telle chose que lâÃtat de droit. Le contrat social appelle des responsabilitÃĐs, tant personnelles que collectives. LâÃĐlection dâun gouvernement lui donne le mandat de gouverner. Son pouvoir, dÃĐlÃĐguÃĐ du peuple à chaque quatre ou cinq ans, lui confie le mandat de prendre les dÃĐcisions quâil juge opportunes. Des balises de la dÃĐmocratie, opposition parlementaire, mÃĐdias, groupes de pression, assurent les bases de la dÃĐmocratie.
Plusieurs jeunes partagent instinctivement ce postulat, mais ils en mettent beaucoup sur la nÃĐcessitÃĐ dâun dialogue avec le pouvoir. Pour eux, un vÃĐritable leader doit placer bien haut dans ses prioritÃĐs une vÃĐrification frÃĐquente auprÃĻs de ses commettants, surtout sur les dÃĐcisions essentielles. Ainsi, le gouvernement sera surtout un porte-parole du peuple. Le pouvoir doit dâabord Être populaire. Dialogue constant, ÃĐcoute humble des voix de la rue.
Cette mÃĐprise provient de deux excÃĻs. Dans un univers ÃĐlectronique, lâinformation se trouve directement accessible. Il sâen dÃĐgage une double caractÃĐristique : les branchÃĐs, soit une substantielle majoritÃĐ, peuvent procÃĐder à des comparaisons immÃĐdiates. Une hausse des frais de scolaritÃĐ ? ! Il y a plusieurs pays oÃđ câest gratuit. Bien mieux, en Finlande, on paie lâÃĐtudiant pour quâil aille à lâÃĐcole ! Lâautre caractÃĐristique, on lâa vue à lâÅuvre tant dans les rues de MontrÃĐal quâau Caire ou à Moscou : le rÃĐseau internaute permet une action de masse immÃĐdiate. LâexcÃĻs populaire consiste à croire quâil tient une moitiÃĐ du pouvoir. Il sâensuit que les tribuns nÃĐs peuvent exploiter cette puissance politique pour dÃĐstabiliser les bases mÊmes de la dÃĐmocratie. Se former un parti ? Ils sâen gardent bien. Ils enseigneront â lâhistoire, la philosophie â ou exerceront leur goÃŧt du pouvoir à travers lâautoritÃĐ syndicale. Bref, le pouvoir sans les responsabilitÃĐs.
LâexcÃĻs complÃĐmentaire provient du gouvernement. HabituÃĐ Ã des bases dÃĐmocratiques bien dÃĐfinies, il ne voit pas toujours la nÃĐcessitÃĐ, voire lâurgence, dâexpliquer clairement et à fond ses positions. Mais lâaveu dâune dÃĐficience dans les menÃĐes de lâÃtat sâavÃĻre un pas par trop difficile à franchir. Comment se fait-il que tout à coup, aprÃĻs tant dâannÃĐes de gel, on augmente soudain les frais de scolaritÃĐ ? En fait, il ne faut pas chercher bien loin. LâÃtat, avec ses quelque 250 milliards de dette, se trouve pris à la gorge. On peut imaginer sans peine des tÃĐlÃĐphones des autoritÃĐs financiÃĻres insistant en termes non ÃĐquivoques : ÂŦLa GrÃĻce sâabime dans la dÃĐliquescence financiÃĻre. LâEspagne et le Portugal ne sont pas loin de la catastrophe ; vous Êtes dans le mÊme sillage. Il est impÃĐrieux que vous redressiez vos finances.Âŧ
Imaginons-nous le parti au pouvoir avouer son incurie financiÃĻre ! ÂŦNous sommes obligÃĐs, à cause de notre incompÃĐtence au fil des annÃĐes, dâaugmenter rapidement les frais de scolaritÃĐ car les banquiers nous mettent le couteau sur la gorge.Âŧ En fait, il sâagit dâun rattrapage. Lâindexation au coÃŧt de la vie aurait produit environ le mÊme montant.
Lâintelligence consistant dans le pouvoir de gÃĐrer lâinformation, les quotients moyens sont de plus en plus dÃĐpassÃĐs par la complexitÃĐ croissante des problÃĻmes. Si bien que le choix  responsable du politicien exigerait un supplÃĐment dâÃĒme quâil a rarement : expliquer au peuple la magnitude et la complexitÃĐ des problÃĻmes et les consÃĐquences souvent ardues que leur solution exige.  Et ainsi, perdre le pouvoir. Ou alors, beurrer le pain populaire de toutes sortes de confitures au-dessus des finances de lâÃtat. Il reste au pouvoir, mais au prix dâune montÃĐe constante de la dette.
Scot Peck, dans Le Chemin le moins frÃĐquentÃĐ, dÃĐfinit la nÃĐvrose comme le refus dâune souffrance utile et salutaire. Les consÃĐquences, explique Peck, seront bien plus lourdes à porter que lâeffort de transparence quâil aurait fallu produire. Nous nous rÃĐveillons donc, comme sociÃĐtÃĐ, avec le fruit empoisonnÃĐ de lâincurie de nos dirigeants.
En somme, voilà une premiÃĻre mÃĐprise. Elle est capitale en ce quâelle porte sur deux attitudes de fond, chacune marquÃĐe dâune carence grave. Dâune part, le pouvoir lÃĐgitime nâest pas dans la rue ; dâautre part, une saine gestion gouvernementale exige une transparence, une humilitÃĐ, une pÃĐdagogie incompatibles avec une passion du pouvoir qui occulte la vÃĐritÃĐ due au peuple.
Dans des articles subsÃĐquents, nous considÃĻrerons les autres niveaux de mÃĐprise impliquÃĐs dans le conflit des droits de scolaritÃĐ.