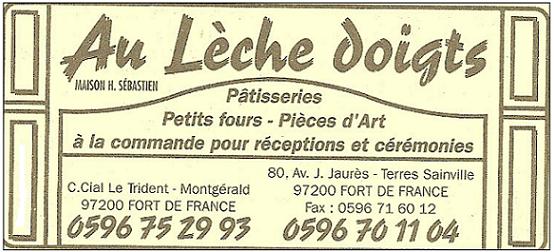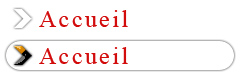La surenchère de l’information – conclusion 1
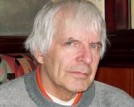 Par Michel Frankland
Par Michel Frankland
Une des constantes de base de toute civilisation consiste dans sa relation au temps.¬Ý Il est en effet n√©cessaire puisqu‚Äôil constitue une condition sine qua non ¬Ý√Ý la notion de signification collective.¬Ý Sans l‚Äôhistoire, il n‚Äôexisterait pas de continuit√©, donc pas de relation entre les g√©n√©rations.¬Ý Pas de sagesse. Pas de cl√©s pour comprendre les circonstances particuli√®res dans lesquelles se d√©bat ce groupe humain.¬Ý Serait de m√™me absente la prudence n√©cessaire pour √©viter les traquenards diplomatiques et les subtilit√©s ennemies.¬Ý Bref, l‚Äôhistoire fonctionne √Ý la mati√®re d‚Äôun GPS collectif.¬Ý Elle marque la route parcourue et propose le cheminement¬Ý le plus appropri√©.
Mais l‚Äôhistoire, prise en charge collective du temps, rec√®le une autre vertu aussi fondamentale que la sagesse. Elle procure au peuple son identit√©¬Ý; de celle-ci se d√©gage une certitude collective qui g√©n√®re paix et bonheur pour le groupe.¬Ý J‚Äôai v√©cu ma jeunesse dans ce que l‚Äôon a √Ý tort nomm√© ¬´La Grande Noirceur¬ª. C‚Äô√©tait un temps heureux. Les familles,¬Ý les institutions, l‚Äô√âglise, les cours classiques et les instituts techniques formaient un tout passablement harmonieux ‚Äì en tenant compte, √©videmment, des vicissitudes de la faiblesse humaine.¬Ý En somme, au profit d‚Äôune sagesse, l‚Äôhistoire ajoute celui, affectif, d‚Äôun bonheur collectif.
Si j‚Äôai √©crit cette longue pr√©sentation en conclusion, c‚Äôest pour montrer, par mode de repoussoir, que les collectivit√©s elles-m√™mes¬Ý sont loin de¬Ý respecter la dimension chronologique de la vie collective.¬Ý J‚Äôen donne deux exemples qui nous touchent de pr√®s.
Au Qu√©bec,¬Ý c‚Äôest un fait reconnu, nous avons rejet√© la p√©riode pr√©c√©dant la R√©volution tranquille. Par un juste retour magique des choses, cette p√©riode a √©t√© qualifi√©e, tel que signal√© plus haut,¬Ý de ¬´Grande Noirceur¬ª.¬Ý La cause √©tait instruite¬Ý: l‚Äôh√©g√©monie de l‚Äô√âglise, la soci√©t√© scl√©ros√©e,¬Ý bref un monde abruti¬Ý dont la R√©volution tranquille ‚Äì Tadam¬Ý! ‚Äì allait nous lib√©rer.
Nous avons en somme¬Ý refus√© la sagesse et le bonheur que procure un commerce f√©cond avec le temps. C‚Äôest pour cette raison que nous avons perdu beaucoup d‚Äôascendant sur les immigrants. Nous avons perdu la s√®ve vitale. C‚Äôest une perte que la raison ne voit pas toujours bien¬Ý; l‚Äôinstinct le saisit. Cette jeune vietnamienne, immigr√©e au Qu√©bec depuis environ 6 ans, brillante autant que discr√®te, est assise dans mon bureau de prof au coll√©gial. La mati√®re r√©gl√©e, je lui demande comment elle per√ßoit le Qu√©bec. Elle h√©site, s‚Äôempourpre. Je sens qu‚Äôelle n‚Äôose pas r√©v√©ler un point de vue qui pourrait me contrarier. Je l‚Äôassure de mon estime. Je vais accueillir tout ce qu‚Äôelle me dira. ¬´On dirait que vous √™tes en orbite. Vous niez votre histoire. Vous √™tes d√©racin√©s.¬Ý Vous √™tes comme amput√©s.¬ª Et dans son pays¬Ý?
Elle me¬Ý fournit une illustration d‚Äôune tradition significative. ¬´Chez nous, quand un type devient voleur, on dit qu‚Äôil n‚Äôa plus de famille. En effet, en tant que hors-la-loi, il est une honte pour sa famille. ¬ª Il s‚Äôest coup√© d‚Äôune source collective vitale. Il n‚Äôa plus de famille, et, d‚Äôune certaine mani√®re, sa nationalit√© s‚Äôen trouve amoch√©e. Autre exemple,¬Ý cette jeune vietnamienne explique une coutume chez les jeunes femmes devenues ¬´famili√®res¬ª des soldats am√©ricains durant la guerre que l‚Äôon sait.¬Ý ¬´Ces filles se coupaient les cheveux. C‚Äô√©tait pour tout le monde un indice social √Ý la fois discret et tr√®s parlant. Une jeune femme dans mon pays portait les cheveux longs, marque de travail sur soi-m√™me et de dignit√©¬Ý toute naturelle. Elles se coupaient les cheveux par respect pour leur famille. Elles ne voulaient pas que leur √©tat de prostitu√©e ternisse l‚Äôhonneur familial. Elles se ‚Äòcoupaient‚Äô donc de leur famille par cette coupe qui voulait tout dire.¬ª
Et c‚Äôest parce qu‚Äôon a des racines d√©p√©ries qu‚Äôon a accept√© l‚Äôhallucinant comit√© des accommodements raisonnables.¬Ý¬Ý Un peuple bien enracin√© dans son histoire aurait tout de suite cri√© √Ý la tentative d‚Äôassimilation. Il aurait requis l‚Äô√©vidence¬Ý: ¬´ Au lieu de commencer √Ý l‚Äôenvers par les accommodements, partons de nos valeurs de fond.¬Ý Et, en regard de ces valeurs, y a-t-il besoin d‚Äôaccommodements¬Ý?¬Ý Si oui, d√©finissons-les pr√©cis√©ment.¬Ý Sinon, que les personnes venues d‚Äôailleurs et qui refusent nos coutumes cherchent sous d‚Äôautres cieux.¬Ý Si elles se sentent en syntonie avec nous, nous les accueillerons. Nous userons du m√™me respect avec ces groupes qu‚Äôils en usent avec nous.¬ª Voil√Ý qui viendrait d‚Äôun peuple¬Ý qui a √©volu√© en continuit√© avec la mouvance historique.
Le d√©racinement connote surtout le monde urbain.¬Ý Mais dans les entrailles du peuple, on n‚Äôa pas quitt√© un commerce f√©cond avec notre chronologie. D‚Äôo√π H√©rouxville, r√©action essentiellement saine, dont les urbains se sont moqu√©s √Ý tort, tout occup√©s √Ý la d√©construction¬Ý des racines qu√©b√©coises. Car il faut √™tre moderne, n‚Äôest-ce pas¬Ý!…
Au total, il n’y a pas de façon plus respectueuse d’accueillir les immigrants qu’en étant soi-même, bien enracinés dans sa propre histoire.
Dans la deuxi√®me partie de la conclusion, nous consid√©rerons la fragilit√© de la perspective anglo-canadienne par rapport √Ý l‚Äôarriv√©e des immigrants. Nous analyserons en quoi la surench√®re d‚Äôinformation en ce domaine les dirige vers une libert√© illusoire.
[1] Mensa Canada Communications, vol. 25, no 9, déc. 1992, pp. 5, 8 et 9.
Michel Frankland
site de bridge jugé incontournable par les experts
http://pages.videotron.ca/lepeuple/___________________________________________________________
Christine Schwab
psychologue compétente et extrêmement honnête avec ses clients
(pas de prolongation inutile de traitement)
www.cschwab.net____________________________________________________________
Henri Cohen
Un expert en pollution domestique et industrielle,
www.coblair.com